D’où vient cette question ? Encore une fois de la vie de Léon Tolstoï (1828 – 1910). Vous vous demandez peut-être quand est-ce que j’aurai fini de parler de cet écrivain russe, mais les questions que s’est posées Tolstoï sont passionnantes et trouvent un écho dans ma propre existence, devrais-je dire dans les existences de chacun d’entre nous ?
Opposition
Opposons l’être social et l’être moral : autrement dit l’être qui adapte ses actes en fonction de son entourage et l’être qui n’obéit qu’à sa propre conscience.
C’est un cas de conscience. D’un côté nous vivons tous en société, nous sommes des hommes et nous sommes donc obligés de nous adapter aux autres hommes qui nous entourent. D’un autre côté l’homme n’en est plus un sans liberté. Il aime décider -vous sentez-vous libres quand on ne vous laisse pas décider ?
La question que je pose est donc la suivante : est-il possible de concilier l’être moral et l’être social qui résident tous les deux en vous ?
- Certains vont dire qu’ils se sentent parfaitement libres même quand ils laissent les autres décider à leur place.
- D’autres vont dire que la liberté s’arrête à partir du moment où l’on enfreint la liberté d’autrui.
Notre conscience est bridée quand on vit en société. Tolstoï voulait vivre dans la pauvreté absolue et suivre les préceptes de sa religion, mais la société dans laquelle il vivait et la classe à laquelle il appartenait l’en empêchaient. Il était bridé.
Cela est vrai pour vous aussi. Vous n’agiriez pas de la même façon si vous n’étiez pas obligés de vous conformer à la société qui vous entoure. Penser ? Agir ? Créer ? Faire ? Vous épanouir ? Oui, vous pouvez, mais seulement dans les limites imposées par la société. L’être social : voilà ce que signifie ce terme. L’être bridé par la société. Un homme seul serait plus créatif.
Et l’être moral, vous entends-je déjà dire ? Certes l’être moral se sent libre et peut s’épanouir sans retenue, mais ne lui manque-t-il pas quelque chose ? Il ne faut pas confondre être moral et être solitaire. Quels sont les instincts que suivrait un être humain libéré de toute contrainte ? La femme, l’homme, sont-ils mauvais par nature ou feraient-ils le bien autour d’eux ? Est-ce dans leur nature de se réunir et de vivre en société, ou l’homme est-il vraiment un loup pour l’homme ?
Mon avis…
J’éprouve beaucoup de difficultés à répondre à ces questions. Je pense que la liberté est le bien le plus précieux de l’être humain et qu’il faut se battre pour la conserver ; voir que notre société contemporaine bascule dans le dirigisme et l’autoritarisme nous rend tous malheureux. Mais à mon avis, l’homme est fait pour vivre en société, ou s’il n’a pas été créé dans ce sens il s’en est adapté parfaitement avec le temps. C’est pour cela qu’il est si facile à contrôler, à commander, à influencer.
La publicité et les politiques influencent les masses. Il n’est pas dur, pour les politiques, de manipuler des foules entières. Il n’est pas dur de détourner notre attention. Parce que, de plus en plus, nous délaissons notre propre volonté pour suivre le troupeau.
Dans Guerre et Paix de Tolstoï (1869), la synthèse culminante de l’épilogue est excellente
Je trouve très cool que Tolstoï ait écrit une histoire de 1 300 pages en faisant défiler des personnages et des intrigues secondaires tout au long de son arc de quinze ans, et qu’il l’ait terminée par un petit épilogue dans lequel il ferme le rideau narratif, entre en scène seul et dit quelques mots sur ce qui l’a préoccupé dernièrement, explique ce qu’il a voulu essayer de faire avec cette chose qu’il a faite.
La deuxième partie de l’épilogue de Guerre et Paix (il y a 2 épilogues) est un essai sur l’histoire ; c’est autant une répudiation de la théorie des « grands hommes » de l’histoire qu’une réfutation du libre arbitre.
J’aimerais partager avec vous quelques mots des dernières pages de Guerre et Paix.
Notre sensation de libre arbitre et de nécessité se contracte ou s’étend graduellement selon le degré plus ou moins grand d’association avec le monde extérieur, le degré plus ou moins grand d’éloignement dans le temps et le degré plus ou moins grand de dépendance à l’égard des causes à travers lesquelles nous examinons le phénomène d’une vie humaine.
Il s’ensuit que si nous considérons la situation d’un homme ayant une association maximale connue avec le monde extérieur, un laps de temps maximal entre son action et tout jugement sur celle-ci et un accès maximal aux causes à l’origine de son action, nous avons l’impression d’une nécessité maximale et d’un libre arbitre minimal. En revanche, si nous considérons un homme dont la dépendance à l’égard des circonstances extérieures est minimale, dont l’action a été commise au moment le plus proche possible du présent et pour des raisons qui nous échappent, nous avons l’impression d’une nécessité minimale et d’une liberté d’action maximale.
Mais dans aucun des deux cas, quelle que soit la variation de notre point de vue, quelle que soit la clarification de l’association de l’homme avec le monde extérieur, quelle que soit l’accessibilité que nous lui attribuons, quel que soit l’allongement ou le raccourcissement du laps de temps, quelle que soit la compréhension ou l’opacité des raisons de son action, nous ne pourrons jamais avoir un concept de liberté d’action absolue ou de nécessité absolue.
Nous avons beau vouloir essayer d’imaginer un homme soustrait à toute influence du monde extérieur, nous ne pourrons jamais parvenir à un concept de liberté dans l’espace. Chaque action d’un homme est inévitablement conditionnée par ce qui l’entoure et par son propre corps. Je lève mon bras et le laisse retomber. Mon action semble être libre, mais lorsque je commence à me demander si j’aurais pu lever mon bras dans n’importe quelle direction, je remarque que je l’ai déplacé dans la direction où l’action rencontrait le moins de résistance de la part des corps environnants ou de ma propre structure corporelle. Si j’ai choisi une direction particulière parmi toutes celles qui étaient disponibles, c’est parce que c’est dans cette direction que j’ai rencontré le moins de résistance. Pour que mon action soit totalement libre, il faudrait qu’elle n’ait rencontré aucune résistance. Pour imaginer un homme complètement libre, il faudrait qu’il existe au-delà de l’espace, ce qui est évidemment impossible.
Nous avons beau raccourcir le délai entre l’action et le jugement, nous ne pourrons jamais parvenir à un concept de liberté dans le temps. En effet, si j’examine une action réalisée il y a seulement une seconde, je dois encore reconnaître qu’elle n’est pas libre, puisque l’action est enfermée dans le moment où elle a été réalisée. Puis-je lever mon bras ? Je le lève, mais cela m’amène à me poser la question suivante : aurais-je pu décider de ne pas lever mon bras dans l’instant qui vient de s’écouler ? Pour m’en convaincre, je ne lève pas le bras l’instant d’après. Mais la non-levée de mon bras ne s’est pas produite à ce premier moment où je m’interrogeais sur la liberté. Un temps s’est écoulé que je n’avais pas le pouvoir de retenir, et la main que j’ai levée alors et l’air à travers lequel je l’ai levée ne sont plus les mêmes que l’air qui m’entoure maintenant et la main que je décide maintenant de ne pas bouger. Le moment où le premier mouvement s’est produit est irrévocable, et à ce moment-là, il n’y avait qu’une seule action que j’aurais pu accomplir, et quel que soit le mouvement que j’ai fait, ce mouvement était le seul possible. Le fait que l’instant d’après je décide de ne pas lever mon bras ne prouve pas que j’avais le pouvoir de ne pas le lever. Et puisqu’il n’y avait qu’un seul mouvement possible pour moi à ce moment précis, il ne pouvait s’agir d’aucun autre mouvement. Pour le considérer comme un mouvement libre, il faudrait l’imaginer comme existant dans le présent, à l’extrême limite de la rencontre du passé et du futur, c’est-à-dire au-delà du temps, ce qui est impossible.
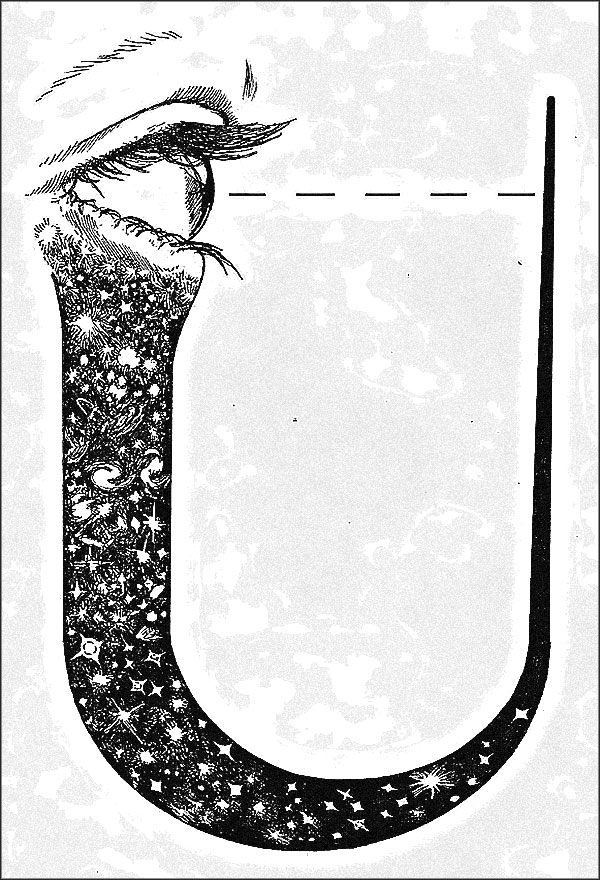
On a beau multiplier les difficultés à cerner les causes, on n’arrive jamais à un concept de liberté totale, d’absence totale de cause. Mais quelle que soit la cause insaisissable à l’origine de l’expression active du libre arbitre, le nôtre ou celui d’autrui, la première exigence d’un esprit intelligent est de rechercher une cause supposée, sans laquelle aucun phénomène n’est concevable. Je lève le bras pour accomplir une action indépendante de toute cause, mais mon désir d’accomplir une action sans cause est la cause de mon action.
Mais même si nous pouvions imaginer un homme exclu de toute influence extérieure et examiner une seule de ses actions momentanées, exécutée dans le présent et non provoquée par une cause quelconque, réduisant ainsi à zéro la quantité infiniment petite de nécessité, nous ne serions pas parvenus à un concept de libre arbitre complet chez l’homme, car une créature imperméable à toute influence extérieure, existant au-delà du temps et ne dépendant d’aucune cause, n’est plus un homme.
De même, nous ne pourrions jamais concevoir une action humaine dépourvue de tout élément de libre arbitre et entièrement soumise à la loi de la nécessité.
- Quelle que soit l’étendue de notre connaissance des conditions spatiales dans lesquelles l’homme habite, cette connaissance ne pourra jamais devenir complète car le nombre de ces conditions est infiniment grand, parce que l’espace lui-même est infini. Et tant qu’il reste vrai que toutes les conditions susceptibles d’influencer un homme ne peuvent être définies, il ne peut y avoir de nécessité totale et il y a toujours une certaine part de libre arbitre.
- Si l’on prolonge le délai entre une action examinée et le jugement que l’on porte sur elle, ce délai sera lui-même fini, alors que le temps est infini, d’où un autre sens de l’impossibilité d’une nécessité absolue.
- Aussi accessible que soit la chaîne de causalité qui sous-tend une action donnée, nous ne pourrons jamais la connaître dans son intégralité, car elle est infiniment longue, de sorte qu’une fois encore, nous ne pouvons atteindre la nécessité absolue.
Et au-delà, même si nous réduisions la quantité minimale de libre arbitre à zéro en reconnaissant son absence totale dans certains cas – un mourant, un bébé à naître ou un idiot -, nous aurions détruit le concept même de ce qu’est l’être humain, ce qui est l’objet de notre examen, car une fois qu’il n’y a plus de libre arbitre, il n’y a plus d’homme. Et donc l’idée d’une action humaine soumise uniquement à la loi de la nécessité et dépourvue de tout libre arbitre est tout aussi impossible que l’idée d’une action humaine totalement libre.
Ainsi, pour imaginer une action humaine soumise à la seule loi de la nécessité et dépourvue de toute liberté, il faudrait postuler la connaissance d’une infinité de conditions spatiales, d’une infinité de temps et d’une infinité de lignes de causalité.
Et pour imaginer un homme parfaitement libre et non soumis à la loi de la nécessité, il faudrait imaginer un homme qui existerait au-delà de l’espace, au-delà du temps et au-delà de toute dépendance à l’égard d’une cause.
Dans le premier cas, si la nécessité était probable sans le libre arbitre, il faudrait définir la loi de nécessité par la nécessité elle-même, c’est-à-dire par une forme sans contenu.
Dans le second cas, si le libre arbitre était possible sans nécessité, nous arriverions à un libre arbitre inconditionnel existant au-delà de l’espace, du temps et de la cause, qui, par sa propre nature inconditionnelle et illimitée, ne serait rien d’autre qu’un contenu sans forme.
En termes généraux, nous serions parvenus à deux principes fondamentaux qui sous-tendent toute la vision du monde de l’humanité : l’essence inconnaissable de la vie et les lois qui déterminent cette essence.
La raison nous dit :
- (1) L’espace et toutes les formes qui lui donnent une visibilité, la matière elle-même, sont infinis et ne peuvent être imaginés autrement.
- (2) Le temps est un mouvement sans fin, sans moment de repos, et ne peut être imaginé autrement.
- (3) Le lien entre la cause et l’effet n’a pas de début et ne peut pas avoir de fin.
La conscience nous dit :
- (1) j’existe seul, et je suis tout ce qui existe ; par conséquent, j’inclus l’espace ;
- (2) je mesure le cours du temps par un moment fixe dans le présent, dans lequel seul je suis conscient d’être vivant ; par conséquent, je suis au-delà du temps ;
- et (3) je suis au-delà de la cause, puisque je me sens la cause de ma propre vie dans toutes ses manifestations.
La raison exprime les lois de la nécessité. La conscience exprime l’essence du libre arbitre.
La liberté illimitée est l’essence de la vie dans la conscience de l’homme. La nécessité sans contenu est la raison humaine sous sa triple forme.
Le libre arbitre est ce qui est examiné ; la nécessité fait l’examen. Le libre arbitre est le contenu, la nécessité est la forme.
Ce n’est qu’en séparant les deux sources de connaissance, qui sont comme la forme et le contenu, que nous parvenons aux concepts mutuellement exclusifs et séparément inimaginables du libre arbitre et de la nécessité.
Ce n’est qu’en les réunissant à nouveau que nous parvenons à un concept clair de la vie humaine.
Au-delà de ces deux concepts, qui partagent une définition mutuelle lorsqu’ils sont réunis, comme la forme et le contenu, il n’y a pas d’autre représentation possible de la vie.
Tout ce que nous savons de la vie humaine est une certaine relation entre le libre arbitre et la nécessité, ou entre la conscience et les lois de la raison.
Tout ce que nous savons du monde extérieur de la nature est qu’il existe une certaine relation entre les forces de la nature et la nécessité, ou entre l’essence de la vie et les lois de la raison.
Les forces de la vie dans la nature se situent au-delà de nous et de nos pouvoirs cognitifs, et nous donnons des noms à ces forces : gravité, inertie, électricité, force vitale, etc. Mais la force de vie de l’homme n’échappe pas à nos pouvoirs cognitifs et nous l’appelons le libre arbitre.
Mais tout comme la force de gravité, intrinsèquement inintelligible bien que perçue par tous, n’est compréhensible qu’en fonction des lois de la nécessité auxquelles elle est soumise (depuis notre première prise de conscience que tous les corps ont un poids jusqu’à la loi de Newton), la force du libre arbitre est également intrinsèquement inintelligible mais reconnue par tous et compréhensible uniquement en fonction des lois de la nécessité auxquelles elle est soumise (depuis le fait que tous les hommes meurent jusqu’à la connaissance des lois les plus complexes de l’économie ou de l’histoire).
Toute connaissance n’est que l’essence de la vie subsumée par les lois de la raison.
Le libre arbitre de l’homme diffère de toutes les autres forces en ce qu’il est accessible à la conscience humaine, mais aux yeux de la raison, il n’est pas différent de n’importe quelle autre force.
Les forces de gravité, d’électricité ou d’affinité chimique ne diffèrent les unes des autres que parce qu’elles sont définies différemment par la raison. Dans le même ordre d’idées, la force du libre arbitre de l’homme ne se distingue des autres forces de la nature que par la définition que lui attribue la raison. Et le libre arbitre séparé de la nécessité, des lois de la raison par lesquelles il est défini, n’est pas différent de la gravité, de la chaleur ou de la force de croissance organique ; aux yeux de la raison, il n’est qu’une sensation fugace et indéfinissable de la vie.
Et de même que l’essence indéfinissable de la force qui meut les corps célestes, l’essence indéfinissable qui anime la chaleur, l’électricité, les affinités chimiques ou la force vitale, forme le contenu de l’astronomie, de la physique, de la chimie, de la botanique, de la zoologie et ainsi de suite, l’essence de la force du libre arbitre forme la matière de l’histoire. Mais de même que le contenu de toute science est la manifestation de cette essence inconnue de la vie, bien que l’essence elle-même ne puisse être que le sujet de la métaphysique, de même la manifestation de la force du libre arbitre de l’homme dans l’espace, dans le temps et dans la dépendance de la cause, forme le sujet de l’histoire, tandis que le libre arbitre lui-même reste le sujet de la métaphysique.
Dans les sciences biologiques, ce que nous connaissons, nous l’appelons les lois de la nécessité ; ce que nous ne connaissons pas, nous l’appelons la force vitale. La force vitale est simplement une expression pour désigner un reliquat inexplicable de ce que nous savons de l’essence de la vie.
Il en va de même pour l’histoire : ce que nous connaissons, nous l’appelons les lois de la nécessité ; ce que nous ne connaissons pas, nous l’appelons le libre arbitre. Aux yeux de l’histoire, le libre arbitre n’est qu’une expression pour désigner un reliquat inexplicable de ce que nous savons des lois de la vie humaine.
L’histoire examine les manifestations du libre arbitre humain par rapport au monde extérieur existant dans le temps et dépendant d’une cause ; en d’autres termes, elle définit le libre arbitre par les lois de la raison, ce qui signifie que l’histoire ne peut être considérée comme une science que dans la mesure où le libre arbitre peut être défini par ces lois.
La reconnaissance du libre arbitre de l’homme comme une force capable d’influencer les événements historiques et donc non soumise à des lois est pour l’histoire ce que la reconnaissance du libre arbitre dans les mouvements des corps célestes serait pour l’astronomie.
Une telle reconnaissance annule toute possibilité d’existence de lois, voire de toute forme de science. S’il existe ne serait-ce qu’un seul corps en mouvement libre, les lois de Kepler et de Newton disparaissent, en plus de cela toute représentation du mouvement des corps célestes. S’il existe une seule action humaine déterminée par le libre arbitre, toutes les lois historiques disparaissent, ainsi que toute représentation des événements historiques.
Pour l’histoire, le libre arbitre des êtres humains consiste en des lignes de mouvement dont l’une des extrémités disparaît dans l’inconnu et l’autre appartient au temps présent, tandis que la conscience du libre arbitre de l’homme se déplace dans l’espace et dans le temps, entièrement dépendante de la cause.
Plus ce champ de mouvement se déploie sous nos yeux, plus ses lois deviennent claires. La découverte et la définition de ces lois est le but de l’histoire.
D’après l’attitude actuelle de la science historique à l’égard de son objet, d’après la manière dont elle cherche actuellement les causes ultimes dans le libre arbitre de l’homme, aucune définition scientifique des lois n’est possible, car, quelles que soient les limites que l’on impose à la liberté d’action de l’homme, dès l’instant où on la reconnaît comme une force non soumise à la loi, l’existence d’une loi devient impossible.
Ce n’est qu’en limitant infiniment cette liberté d’action, en la réduisant à un minimum infinitésimal, que nous parviendrons à connaître l’impossibilité absolue de trouver des causes, et alors, au lieu de les chercher, l’histoire pourra se donner pour tâche de chercher des lois. …
De même qu’en astronomie le problème de la reconnaissance du mouvement de la terre résidait dans la difficulté de s’affranchir de la sensation directe de l’immobilité de la terre et de la sensation similaire du mouvement des planètes, de même en histoire le problème de la reconnaissance de la dépendance de la personnalité à l’égard des lois de l’espace, du temps et de la causalité réside dans la difficulté de s’affranchir de la sensation directe de sa propre indépendance personnelle. Mais de même qu’en astronomie la nouvelle attitude a été : « Non, nous ne pouvons pas sentir le mouvement de la terre, mais si nous acceptons son immobilité nous sommes réduits à l’absurde, alors que si nous acceptons le mouvement que nous ne pouvons pas sentir nous arrivons à des lois », de même en histoire la nouvelle attitude est : « Non, nous ne pouvons pas sentir notre dépendance, mais si nous acceptons le libre arbitre nous sommes réduits à l’absurde, alors que si nous acceptons la dépendance du monde extérieur, du temps et de la causalité, nous arrivons à des lois ».
Dans le premier cas, il fallait se défaire d’une fausse sensation d’immobilité dans l’espace et accepter un mouvement que l’on ne sentait pas. Dans le cas présent, il n’est pas moins indispensable de se défaire d’une fausse sensation de liberté et d’accepter une dépendance que l’on ne peut pas sentir.
Quelle philosophie de vie en tirer ?
Tout d’abord, la notion de VIE est galvaudée. La vie ne fait que décrire nos actions. La vie ne se voit pas. Les actions que nous utilisons ont des conséquences. Dites à une personne qu’elle est stupide, elle répondra par la négative. Si vous dépensez trop, vous aurez des factures, etc.
Le sens de la vie est d’en faire l’expérience de la meilleure façon possible, rien de plus. L’expérience est donc la réponse, tout simplement.
La complication vient du fait que nous attendons qu’on nous donne quelque chose. Nous attendons de la nourriture, de l’amour, de la reconnaissance, du respect, et lorsque ce n’est pas le cas, nous devenons stressés. L’attente est donc le mal de notre vie. Nous ne devons rien attendre et, lorsque nous recevons quelque chose, nous devons remercier pour ce que nous venons de recevoir.
C’est une vie simple. De mon point de vue, je dirais que l’une des prises de conscience de tout penseur sérieux sur la nature de la réalité est qu’elle existe et qu’elle n’a apparemment pas de but, que la vie est essentiellement aléatoire, que la chance n’existe pas et que vous n’êtes rien de spécial dans le monde en général.
Les dieux et le destin ne se soucient pas de vous parce qu’ils n’existent pas. Vous n’avez pas eu le choix conscient du moment et du lieu de votre naissance ; et vous n’aurez probablement pas le choix conscient de la fin de votre vie ou de la manière dont elle se terminera.
→ Cliquez pour lire :
La vie montre qu’elle n’a pas de sens réel, c’est vrai pour vous et pour presque tout ce qui existe
Des brins d’ADN autoreproducteurs aux grenouilles et aux oiseaux, en passant par les insectes et les êtres humains, ils exercent l’activité nécessaire à leur survie, mais ce n’est que ce qu’ils font, pas pourquoi ils le font. C’est parce qu’il n’y a pas de « pourquoi » et qu’il n’y a pas besoin d’en avoir.
La réalité est ce qu’elle est et il est préférable de la prendre au pied de la lettre et de la vivre comme un événement parmi d’autres. Que vous appréciiez cet événement ou que vous le trouviez détestable dépend de vous, la douleur d’un homme est le plaisir d’un autre, etc, mais considérer l’univers comme dépourvu de sens peut être le point de départ de la liberté et d’un bonheur surprenant.
Personnellement, j’estime que la seule chose que vous devez faire est de prendre votre prochain souffle et de continuer à vivre. Le défi de la philosophie est simplement le suivant : « Pourquoi devrais-je rester en vie ? »
La réponse à cette question dépend de la personne qui la pose et varie toujours d’une personne à l’autre. Tout ce que vous pouvez en déduire, c’est que le sens que vous donnerez à votre vie sera quelque chose qui vous conviendra. Si vous me demandez pourquoi je suis philosophe alors que mon ami est ingénieur, c’est parce qu’il n’y avait pas d’autre choix, vous pourriez tout aussi bien demander pourquoi les oiseaux chantent tous comme ils le font. Ils le font tout simplement et c’est tout ce qu’il y a à faire.
Il n’y a pas de sens unique à la vie, vous devrez trouver le vôtre et faire quelque chose que vous trouverez personnellement pour valider votre existence ou non. C’est votre choix. Cela peut vous rendre heureux ou non. L’univers n’exige pas que vous soyez heureux, mais si vous pouvez l’être, c’est clairement un avantage.
À l’exception d’Épicure et des anciens stoïciens, la philosophie occidentale n’est pas toujours la meilleure pour conduire un homme au bonheur, mais il existe une alternative orientale qui s’appelle vivre dans l’instant ou l’art du zen, essayez d’observer sans réagir et essayez la méditation comme technique pour vous aider à vivre plus pleinement dans le présent.
La raison pour laquelle toutes nos expériences se produisent « maintenant » est qu’il n’y a pas de moment plus important que « maintenant »
Ce que vous faites « maintenant » n’a pas d’importance, tout ce qui est important est que vous en fassiez l’expérience et que vous le fassiez pour lui-même.
La seule chose qui est évidente, c’est que les êtres humains vivent leur vie ici, dans le moment présent, et que nous sommes tous obligés de le faire. Par conséquent, le sens de la vie est de continuer à en faire l’expérience, indépendamment de tout jugement de valeur que vous pourriez porter sur ces expériences.
Si vous assistez à un magnifique coucher de soleil, vous noterez les couleurs du ciel sur les nuages. À ce moment-là, rien n’est plus important que l’expérience de ce moment dans cet événement. Et ce, que vous ayez aimé ou non le coucher de soleil. Il en va de même pour les personnes, les lieux, les moments, les événements et les autres êtres tels que les animaux domestiques et les animaux de compagnie.
L’expérience de voir cette belle jeune fille à vélo ou ce couple de personnes âgées marchant le long de la rivière, l’homme qui crie après ses collègues de travail ou le jeune enfant qui joue avec son chien de compagnie est la chose la plus importante à tout moment.
Tout ce qui touche vos sens est ce dont vous devez faire l’expérience en ce moment, vous devez l’absorber aussi intensément que possible, car il n’y a rien d’autre à faire que de prendre la prochaine respiration.
L’univers n’est qu’un vaste moteur d’expériences et vous en faites partie. Il s’expérimente de bien des façons à travers les nombreuses formes de vie qui existent. Cela peut vous amener à réaliser que nous sommes tous une seule et même chose, mais cela aussi n’a pas d’importance. Vous faites l’expérience de ce que font les autres et vous devenez l’objet d’expériences pour d’autres personnes. La réalité est simplement… équilibrée et belle, et c’est tout ce qu’il y a à faire.
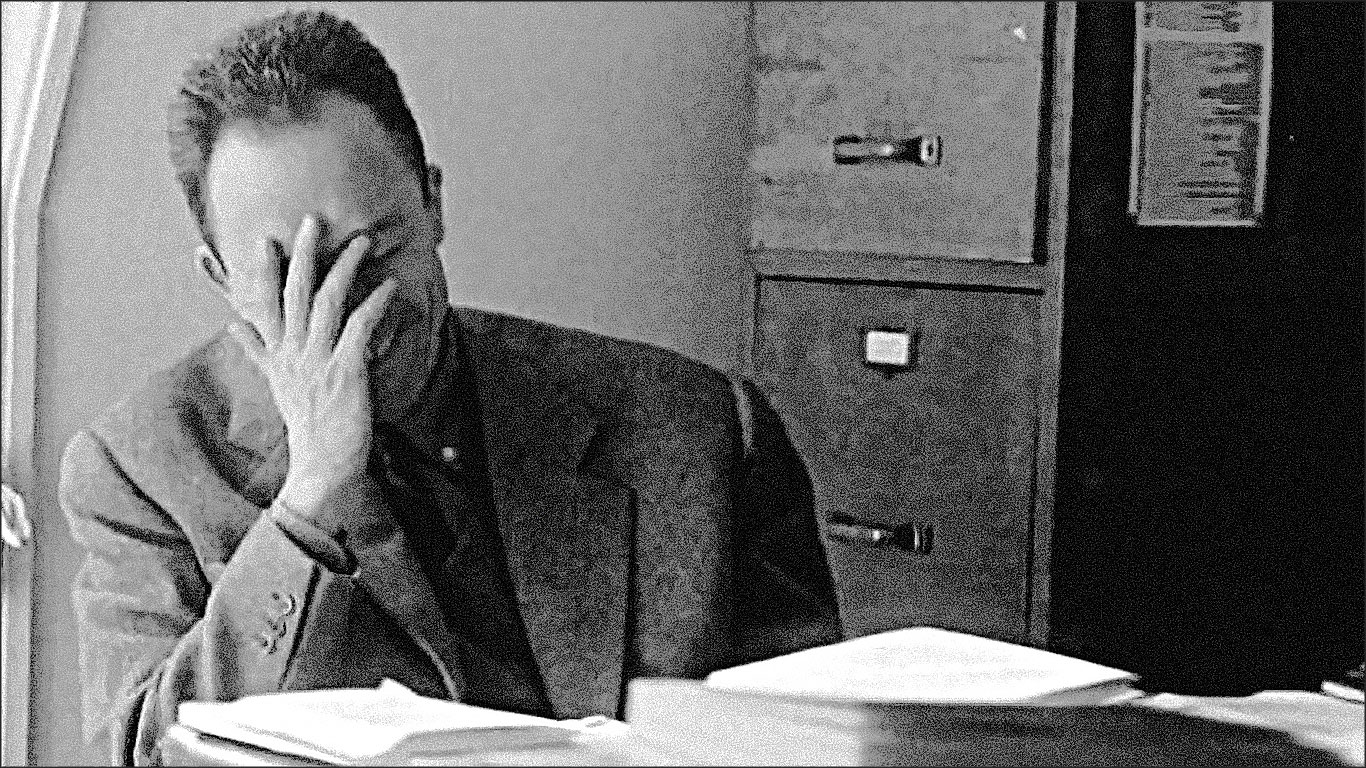
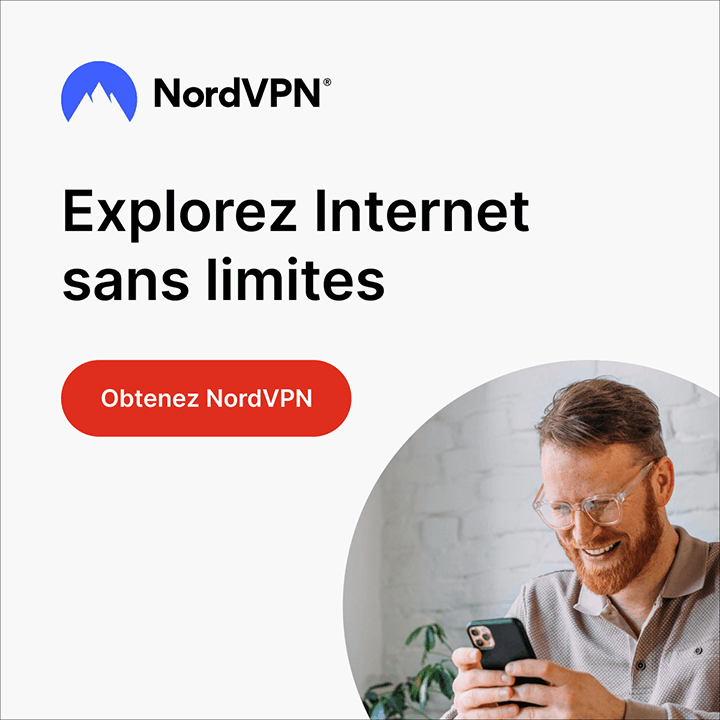
Merci de ton témoignage ici, et au plaisir de se recroiser ^^ 🙂
Si par malchance le modéle de société dans lequel on vis n est pas adequation avec l etre moral que nous sommes s’en suis l exclusion…
L etre humain n est fait pas fait pour vivre seul je pense que ne pas perdre sa moralité est impossible il faut faire une concession « mentir en société » et pour ce qui est de ses actes appliquer
ses idéaux.
A titre personnel je n ai pas choisi le mensonge c est sans doute la voie la plus difficile j appelle ça « la voie du samourai »
Merci pour se blog retrouvée sur la mer de google
ça m a donné envie de lire: »tolstoi » :-°)
Tu sembles penser qu’on ne peut pas à la fois être social et être moral et qu’une fois qu’on a basculé d’un côté, il est très difficile d’en revenir. Pour ma part j’adhère plus à l’idée que ces deux visages de nous-mêmes résident en nous et qu’il s’agit d’une bataille de tous les instants entre notre côté sauvage, instinctif, et la facilité qui consiste à suivre les autres.
On appartient au troupeau depuis notre naissance. On nous a appris ses règles, la façon de vivre dedans. c’est comme marcher, on nous l’a appris. Qui dit que nous ne serions pas plus habile avec nos bras si on ne nous avait pas appris à développer cette faculté ?
Et tant que nous rentrons dans le moule, et tant que la société répond à nos attentes, selon des besoins qu’elle a elle-même créé, alors on ne sentira rien passer.
C’est oublier que, même si nous sommes issu de la même société, nous avons des vécus différents, un passé qui nous est propre. On est tributaire de l’éducation qu’on a reçu et des événements qui nous ont frappé.
Si une fois passé l’âge de raison (ou l’adolescence), rien de spécial ne nous arrive, ou bien que l’entourage proche crée un cocon, alors nous ne sortirons pas du troupeau. Il y a un manque d’introspection.
Pur produit de société, chacun a des rêves, à peu près défini. En se confrontant aux autres, on comprends qu’ils n’ont pas les mêmes codes que soi, du fait de leur passé original.
Si par hasard, il arrive que les rêves et idéaux d’une personne formatée socialement sont détruits, si le parcours fait mine de s’arrêter, les jours se suivent et se ressemblent et on ne sait pas où on va, alors il y a, à mon sens, deux solutions : soit on suit le troupeau, soit on s’arrête et on fourni un travail d’introspection. Le bonheur viendra-t-il de la société, cette chose qui formate les gens, ou bien tient-on dans nos mains notre propre avenir ? Muni de nos propres pensées, on trouvera un nouveau chemin. Bien que socialement on pourra continuer à faire semblant, pour ne pas être la brebis galeuse, la libération de notre pensée nous emmène sur une vision extériorisée. Le système se révèle : sa réalité et son fonctionnement.
Malgré tout, le fait de comprendre le mécanisme du système nous empêche de nous en affranchir.
Euh .. ouais pas évident à s’exprimer sur ce sujet .. je dirai qu’il faut faire un choix personnellement et qu’il est très difficile de concilier l’être moral et l’être social.